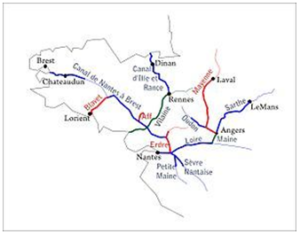Par Jean-Yves Raude – Février 2020
Breton originaire de l’île de Groix et de Paimpol, Jean-Yves Raude a débuté dans la vie comme technicien des télécommunications. Il a ensuite été le directeur commercial de la Monnaie de Paris puis, intégré au corps des administrateurs civils, a œuvré à la direction du Budget, à Bercy. Après un passage dans un cabinet ministériel, il est devenu directeur du Service des Retraites de l’État, à Nantes. Il a terminé sa carrière comme délégué aux finances publiques pour la région d’Ile-de-France. Entre deux navigations avec sa compagne, il vit à Saint-Brieuc.
Le site Montesquieu
« Faut-il partir ? rester ? Si tu peux rester, reste ; pars, s’il le faut. L’un court, et l’autre se tapit pour tromper l’ennemi vigilant et funeste, le Temps ! » Pour Baudelaire, cela ne s’est pas toujours bien terminé… Je devais réaliser un vieux rêve : partir sur les océans, loin, à la découverte de l’ailleurs, mais aussi, plus intimement, de moi-même…
Ce projet, nous l’avons réalisé à deux, sur un voilier de 11,50 mètres, vieux de trente ans, que nous avions choisi dans cette intention : bien construit par un chantier de Plymouth, en polyester renforcé fibre de verre, pas très rapide mais solide et sûr. Nous l’avons équipé pour le grand large avec :
- une éolienne et des panneaux solaires pour assurer l’autonomie en énergie ; certes, le moteur auxiliaire peut recharger les batteries, mais cela consomme du gazole et le réservoir ne contient que 200 litres – qu’il faut garder pour propulser le bateau en cas de besoin ;
- un dessalinisateur pour produire la ressource rare et vitale qu’est l’eau douce, les réservoirs n’en contenant que 250 litres ;
- un régulateur d’allure, système qui permet de diriger le bateau avec l’unique énergie de l’air, en conservant un angle constant avec la direction du vent ; on ne peut pas barrer le bateau 24 heures sur 24, même à deux ;
- un émetteur récepteur AIS (automatic identification system) pour détecter les autres navires et être détecté par eux de manière plus économique en énergie que le radar ; cet appareil donne le nom, le pavillon, la taille, le cap, la vitesse des navires croisant dans un rayon de plusieurs dizaines de milles nautiques ; il émet une alarme de risque de collision, mais ne dispense pas d’une vigilance constante car tous les bateaux n’émettent pas ;
- un traceur qui, connecté au GPS, donne la position et la trace du bateau, à condition d’avoir au préalable enregistré les cartes électroniques de toutes les destinations ; nous avions chargé celles du monde entier ;
- une balise EPIRB qui, en cas de détresse, émet un signal satellite et déclenche les secours ;
- un téléphone satellite pour consulter la météo en tous points du globe, rassurer les proches et communiquer avec la terre ou avec des bateaux naviguant au-delà de la portée de la VHF ;
- une pharmacie complète pour parer à toute éventualité : maladies, blessures profondes, malaises graves.
Ainsi équipés, nous pouvions partir. Ou presque ! Le grand large est souvent hostile, et surtout désert. L’autonomie, c’est aussi être capable de réparer ce qui casse ou tombe en panne, que ce soit le matériel ou l’équipage. Nous avons donc complété notre préparation par des stages de secours en mer, de mécanique moteur, et par un entraînement physique quotidien pendant les mois précédant le départ.
30 juin, c’est le grand départ pour un voyage qui doit se terminer aux antipodes, en Australie ou en Nouvelle Zélande, en un peu plus d’un an.
Pour la première étape, nous visons Vigo, en Espagne. Ce n’est pas une très longue route, environ une semaine, mais ce n’est pas la plus simple. Il nous faut sortir de la Manche – nous partons de Saint Brieuc – et traverser le Golfe de Gascogne. Mieux vaut le faire en été qu’en hiver, même si le risque de mauvais temps n’est jamais nul. Nous profitons d’une dépression à peu près stationnaire centrée au large de la côte française atlantique pour nous lancer vers l’Ouest avec un vent favorable de secteur Est. La première difficulté est de franchir la route des cargos qui remontent du rail d’Ouessant ou s’y dirigent : nous y croisons la route montante à la tombée de la nuit, puis la route descendante en milieu de nuit. La meilleure technique est de passer derrière les monstrueux porte-conteneurs plutôt que devant, mais sans trop s’attarder car le suivant n’est jamais loin. L’AIS nous apporte un grand confort en traçant sur l’écran la trajectoire de collision. L’année précédente, nous avions traversé la Manche avec des moyens moins perfectionnés… et de grosses émotions !
En sortie de Manche, à hauteur de la pointe de la Bretagne, la mer s’agite. La houle d’ouest et les vagues d’est forment des creux de quatre mètres qui nous secouent en cette première nuit au large. Il va falloir s’y habituer et renoncer à l’immobilité que le sommeil réclame ordinairement. En traversée, le sommeil est le premier défi. À deux, ce ne sont pas des « quarts » mais des demi-nuits qui permettent de garantir la veille. Quand vient son tour, pas d’autre solution qu’un sommeil fractionné à trouver en se calant le moins inconfortablement possible. À la voile, le chemin le plus rapide d’un point A à un point B est rarement la ligne droite. Pour cette traversée, la meilleure solution est de rester sur les bords de la dépression pour conserver les vents portants. Nous décrivons donc un large arc de cercle qui nous emmène à la latitude de l’ouest de l’Irlande (14°W).
L’océan est immense, mais c’est une vision théorique. Du fait de la courbure de la terre, à une élévation de deux mètres de la surface, l’horizon n’est qu’à 5 ou 6 km. La galette liquide sur laquelle nous nous déplaçons, ou plutôt que nous déplaçons, a donc une surface d’environ 100 km2. Excepté les escales, ce sera désormais notre domaine, mais hors de question d’y poser un pied ! Le risque n°1 est de passer par-dessus bord. Dès qu’il faut aller manœuvrer sur le pont, ou que le temps est mauvais, et en permanence la nuit, nous nous attachons à une ligne de vie.
Après une bonne semaine de navigation au vent portant, nous abordons les côtes espagnoles, et faisons escale aux îles Cies, près de Vigo, après avoir croisé plusieurs baleines au large du cap Finistère. La terre, quand on vient du large, on la sent avant de la voir : odeurs mêlées d’humus et de plantes parfumées, mais aussi et moins agréable, odeurs d’activités humaines. C’est une émotion toujours renouvelée quand la terre apparaît au loin, promesse de repos, de rencontres et d’émerveillements.
Après un cabotage de quelques semaines le long des côtes portugaises et une plus longue escale à Lisbonne à la rencontre de Fernando Pessoa et du fado, nous reprenons le large, direction Madère. Il n’y a pas de traversée banale, si courte soit-elle. Nous ferons cette route en trois jours, à une moyenne de sept nœuds, au grand largue, vent soufflant de 25 à 35 nœuds et vagues jusqu’à six mètres de creux. Dans ces conditions de navigation, une vigilance constante s’impose ; un empennage intempestif peut vite tourner à la catastrophe. Espars brisés, voiles déchirées, chavirage, que d’histoires avons-nous entendues lors de nos escales, de navigateurs pour lesquels l’aventure s’est brusquement arrêtée ! Au moins deux de nos amis ont perdu leurs bateaux, échoués sur des récifs et irrécupérables. Un voilier qui partait pour un tour du monde a perdu son gouvernail, brisé net, trois jours après être parti des Canaries pour la traversée de l’Atlantique : l’équipage a fini le voyage sur un cargo, destination Panama…
Vigilance, cela signifie être à l’écoute du moindre bruit nouveau, en identifier la provenance et réparer si nécessaire. Cela suppose aussi de guetter les changements de temps pour réduire la toile avant qu’il ne soit trop tard, de scruter l’horizon (idéalement toutes les vingt minutes) pour éviter d’éventuelles collisions. La vigilance, c’est aussi garder la tête froide – pas d’alcool – car l’imprévisible n’est jamais à exclure quand on sait, par exemple, que des milliers de containers tombent à l’eau chaque année et qu’une partie d’entre eux flottent entre deux eaux, indétectables. Certes, il faut une certaine dose de malchance pour en percuter un, mais lorsque cela arrive, l’histoire se termine sur un petit radeau… Nous étions prêts « au cas où » : un sac étanche avec le nécessaire de survie, la liste de ce qu’il ne faut pas oublier au dernier moment (téléphone satellite, combinaisons étanches… ), le couteau toujours à portée de main pour se détacher du bateau au moment où il sombre. Et surtout : rester serein malgré cette menace !
Après Madère, cap au Sud vers les Canaries puis les îles du Cap Vert. La nuit, Bételgeuse dans la constellation d’Orion et Aldébaran dans les Hyades brillent à gauche du mât. Au passage du Tropique du Cancer, nous sommes début décembre, et il fait encore frais. Plusieurs coups de vent à plus de 30 noeuds nous malmènent sous les nuages et agacent la mer. Un claquement sec, lorsque le bateau roule sur un bord puis sur l’autre, résonne au milieu de la nuit et nous inquiète. Après dix minutes de recherche, nous l’identifions : c’est la cuve à gazole – 300 kilos – qui s’est détachée. Calage et collage de fortune, nous réparerons plus solidement au port.
Le Cap Vert, première escale non européenne. Nous avions rempli les formalités de sortie (clearance ou clairance) de la zone européenne aux Canaries. La première chose à faire en arrivant est de rendre visite aux services des douanes et à ceux de l’immigration. Nous ferons cela à chaque fois, en arrivant puis en quittant un territoire – exercice souvent fastidieux mais toujours très instructif sur « l’ambiance » administrative et l’état des services publics des différents pays. J’avais appris les rudiments de portugais nécessaires pour se nourrir, se déplacer et s’expliquer. Cela nous a servi au Portugal, à Madère et maintenant au Cap Vert. Même si l’anglais est pratiqué partout (plus ou moins compréhensible), quelques mots, même maladroits, dans la langue locale, déclenchent des sourires et facilitent grandement les rencontres, voire accélèrent les formalités !
24 décembre au matin : après une dizaine de jours à Mindelo, nous nous préparons à quitter cet attachant pays pour la première grande traversée : celle de l’Atlantique. Nous sommes suffisamment au sud pour bénéficier des alizés, vent qui souffle du Nord-Est dans l’hémisphère Nord (du Sud-Est dans l’hémisphère Sud) et de manière régulière à 15-20 nœuds. C’est du moins ce que disent les livres… Si tout va bien, la traversée durera une petite quinzaine de jours. Nous faisons des provisions pour six semaines. Riz, pâtes, biscuits, céréales et légumineuses en constituent la base, à laquelle s’ajoutent quelques boîtes de sardines et de pâté, et des fruits et légumes achetés au marché local (ceux des supermarchés, ayant souvent été refroidis, ne se conservent pas). L’approvisionnement doit être très étudié, avec peu de denrées à faible durée de conservation : un régime de bananes vertes (avec l’inconvénient qu’elles mûrissent toutes en même temps !) et beaucoup de citrons et d’oignons. Riz et oignons, c’est le menu quotidien quand tout le reste est gâté ! Nous comptons aussi sur notre pêche…
Les alizés sont au rendez-vous mais plus Est que Nord-Est, donc exactement vent arrière. Une allure très inconfortable – le bateau roule – et qui pousse moins, car la vitesse du bateau se retranche de celle du vent. Il nous faut donc zigzaguer pour prendre un peu de travers. La route en est allongée. La ligne traîne derrière le bateau et dès le premier jour nous remontons une « petite » dorade coryphène de 80 cm, qui nous assure les repas pour deux jours.
Une des magies de la haute mer, c’est le ciel. Quand nous le regardons depuis nos contrées civilisées, nous voyons quelques dizaines, au mieux quelques centaines d’étoiles. En pleine mer, une fois éteints tous les instruments, à l’abri de toute pollution lumineuse, il est impossible de compter les étoiles : mille, deux mille, plus ? S’imaginer alors comme un point incroyablement infime dans un coin de notre galaxie dont la Voie lactée donne la dimension. Se dire qu’elle contient deux cent milliards d’étoiles, et qu’elle est elle-même quelque part parmi deux cent milliards de galaxies, estimation sans doute provisoire. Ressentir profondément ce vertige qui nous remet à notre place. Méditer sur les folles ambitions et l’insatiable avidité des hommes qui consomment toujours plus que ce que la nature peut offrir, et détruisent à grande vitesse notre précieuse planète.
Nous passons à l’an neuf au milieu de l’Atlantique et … le vent tombe complètement ! Deux jours de quasi-immobilité, car nous n’utilisons pas le moteur pour réserver le carburant en cas de coup dur. Repos, petites réparations, baignades par cinq mille mètres de fond, au-dessus de ces abysses si proches et pourtant si peu explorées. Pas trop longues les baignades, inutile de provoquer les requins… Nous remontons notre quatrième dorade coryphène, la plus grosse – 1,15 mètre – de quoi aborder sereinement la deuxième partie de la traversée. Une aubaine ! Car la deuxième moitié de la traversée se fera sans pêcher : la mer est couverte de plaques de sargasses, ces algues pélagiques qui se développent en pleine mer. Impossible de traîner une ligne !
Aborder un endroit inconnu de nuit peut être périlleux. Les feux des balises ne fonctionnent pas toujours, et les bouées et filets posés près des côtes par les pêcheurs sont indiscernables. Pour arriver au lever du jour à Bequia, nous ralentissons en passant sous le vent (à l’ouest) de l’île de Saint-Vincent. La traversée aura duré dix-huit jours.
On me demande souvent si je me suis ennuyé. Pas un seul instant ! La marche du bateau réclame une attention constante. Le spectacle de la mer le jour, du ciel la nuit, des levers et couchers de soleil, est sans cesse renouvelé. Un soir, après une journée d’une exceptionnelle limpidité, à cet instant précis où la dernière parcelle du soleil se noie à l’horizon, nous avons vu le « rayon vert ». J’attendais cela depuis mon enfance. Mon père, lors de nos courtes navigations côtières en Bretagne, disait souvent au coucher du soleil : « Regarde, nous allons peut-être voir le rayon vert !». Ce n’était jamais arrivé…
Et puis, il y a la lecture, avec l’inconvénient de ne pouvoir embarquer qu’une très maigre bibliothèque. J’ai donc adopté la liseuse (option étanche) : 400 livres sur une fine tablette et 6000 de plus sur l’ordinateur de bord. Pas besoin de lampe la nuit ! Et nulle nécessité de tenir les pages quand le vent souffle ! Durant cette traversée je n’aurai lu qu’une dizaine d’ouvrages, dont quand même Les Misérables relus dans leur version intégrale.
Les sauts de puce tout au long de l’arc antillais nous donnent l’occasion de superbes mouillages, des Grenadines aux Îles Vierges britanniques, en passant par Sainte-Lucie, la Martinique, la Guadeloupe, Les Saintes, Marie-Galante. J’y avais navigué il y a trente ans. Le changement le plus spectaculaire est l’impressionnant accroissement du nombre de bateaux : la multiplication des grands yachts, et surtout les catamarans de location, massifs, souvent manœuvrés par des équipages peu expérimentés qui ne hissent pas les voiles… Observation : les grands bateaux (plus de 15 mètres) sont immatriculés à Nassau, La Valette, Georgetown… Les petits le sont à Nuremberg, Cherbourg, Plymouth, Saint-Brieuc, Toulon… Les propriétaires des premiers ne parlent pas à ceux des seconds. Deux mondes se côtoient à quelques mètres, mais s’ignorent. Autre changement : le développement du tourisme de masse, notamment avec les paquebots de croisière qui déversent chaque matin des baleinières pleines de passagers qu’ils récupèrent l’après midi pour naviguer la nuit vers une nouvelle île. Autour des points de débarquement se sont installés restaurants et coquettes boutiques de souvenirs et de fruits exotiques. Mais là où les paquebots ne s’arrêtent pas – ou plus – ne restent souvent que le dénuement et la pauvreté. Le croisiériste n’aura vu que le « bon » côté.
L’escale à Pointe-à-Pitre est l’occasion de visiter le remarquable Mémorial Act, musée consacré à l’esclavage. La mémoire et le ressentiment restent vifs dans les îles qui ont été le terrain de cette honteuse exploitation humaine. Les plaies ne sont pas refermées, et les relations avec « l’homme blanc » qui débarque, même si elles sont le plus souvent chaleureuses, en restent au fond un peu faussées.
Depuis Pointe-à-Pitre nous faisons route vers Virgin Gorda, aux Îles Vierges britanniques. Les rivages sont magnifiques. Mais derrière la carte postale, la réalité est plus sombre : en 2017, l’île a été dévastée par le cyclone Irma. Les habitants travaillent encore inlassablement pour reconstruire. Et, comme ailleurs, les côtes Est, exposées aux vents et à la houle, sont des décharges à ciel ouvert envahies de bouteilles et sacs en plastique, déversés par le reste du monde… Nous avions déjà vu cela au Cap Vert. Le plastique est le fléau majeur qui tue à petit feu la vie marine dont notre survie dépend. Il y a urgence absolue à éradiquer le sac en plastique. Et pas en 2040 !
Sept jours de navigation au nord de la République Dominicaine et d’Haïti dont nous rasons la fameuse île de la Tortue, vers Santiago de Cuba. Après un épisode agité dans le Winward Passage, nous longeons tranquillement la côte cubaine. Le premier message provenant de la terre nous enjoint virilement de nous éloigner sans délai ! L’émetteur est… la base américaine de Guantanamo.
On nous avait dit que les formalités d’entrée à Cuba étaient particulièrement longues, pointilleuses et pénibles. Eh bien non ! Après nous avoir demandé de jeter l’ancre à une encablure du ponton, les autorités locales, un douanier et une représentante du ministère de l’Agriculture, montent à bord et, après avoir pris notre température au moyen d’un thermomètre électronique posé sur le front, nous posent les questions d’usage : drogue, armes, nourriture, maladies ? Puis la conversation est cordiale autour d’une bière fraîche. Nos interlocuteurs restent étonnés que nous soyons venus à deux de France sur un si petit bateau. Après quelques jours de visite à Santiago, sans oublier les tombes de Fidel Castro et de Compay Segundo, nous reprenons la mer vers Cienfuegos, avec une halte dans les Jardins de la Reine, immense archipel quasi désert, lieu préservé de reproduction de la faune marine, et en particulier de certaines espèces de requins.
Trois semaines à Cuba, quelques jours à La Havane, c’est trop court pour comprendre ce pays passionnant. Mais il nous faut gagner Panama, pour préparer la traversée du Pacifique dans de bonnes conditions météorologiques. Six jours de traversée de Cienfuegos à l’entrée du Canal, en ligne presque droite. Nous traversons l’archipel des Caïmans avant d’aborder une zone de cayos [1], récifs coralliens affleurants ou légèrement émergés. Sur la carte, les icônes d’épaves nous rappellent que c’est par les naufrages que la position exacte des récifs a pu être fixée. Pensées pour tous les équipages qui ont été projetés par le vent et les vagues sur ces cailloux aussi inhospitaliers dans la réalité que paradisiaques sur les cartes postales. Avec des cartes nautiques justes et des instruments fiables, nous passons sans encombre, mais il ne faut quand même pas s’endormir trop longtemps !
Les abords de l’entrée du Canal de Panama sont, comme nous nous y attendions, bien encombrés. Une bonne partie des routes maritimes commerciales s’y concentre. Les imposants cargos et porte-conteneurs entrent, sortent, stationnent en attendant leur tour. Ils sont quatorze mille à passer par là chaque année. Il fait une chaleur étouffante. C’est le moment que choisit notre moteur pour s’arrêter. S’il y a une circonstance où le moteur est indispensable, c’est pourtant bien pour passer le canal et ses écluses ! Pas de panique, un moteur diesel, ce n’est pas compliqué : il faut du gazole et de l’air pour le mélange explosif, une pompe pour l’injecter dans les cylindres, et de l’eau pour refroidir le tout. Cette fois, c’est l’arrivée d’air qui semble insuffisante. Nous ouvrons les capots pour satisfaire l’appétit de la machine, et c’est reparti.
Panama ! Nous allons passer de l’Atlantique au Pacifique. Moins glorieux que de virer le cap Horn, mais c’est quand même un moment particulier pour tout marin. Plusieurs navigateurs rencontrés de l’autre côté nous ont confié qu’ils avaient mis plusieurs années à se décider. Le Pacifique est immense, et les milliers de milles nautiques à franchir sans escale pour aller au bout du monde impliquent un éloignement considérable. Après plus d’une semaine d’attente, notre passage est programmé sur deux jours. Le premier, nous passons les trois impressionnantes écluses montantes, (300 mètres de long sur plus de 30 de large) qui nous hissent de 25 mètres jusqu’au lac de Gatún. Quand la porte se referme sur l’Atlantique, j’ai l’impression de quitter un monde. Le bateau doit être solidement arrimé par quatre amarres pour résister aux violents courants qui nous bousculent quand les cent mille mètres cubes d’eau envahissent l’écluse en quelques minutes. Nuit au mouillage à la sortie des écluses. Je ne résiste pas à l’envie d’une baignade dans l’eau douce à sept heures du matin, mais pas trop longue pour ne pas tenter les crocodiles dont nous avions aperçu quelques beaux spécimens sur le rivage. Sous la direction du pilote officiel : plus vite, moins vite, plus à droite, plus à gauche, stop, go … nous franchissons les 70 km du canal dans la journée. La dernière porte des écluses de Miraflores s’ouvre enfin sur le Pacifique. Nous ne reviendrons pas en arrière…
Nous avions longuement réfléchi aux préparatifs de la traversée du Pacifique, dont le principal aléa est le passage du « Pot au noir », zone de convergence intertropicale, à proximité de l’Equateur. Au nord de la zone, les alizés soufflent du Nord-Est. Au aud, ils viennent du Sud-Est. Au milieu, dans une bande plus ou moins large de quelques centaines de kilomètres, pas de vent et des grains parfois impressionnants. Si le moteur fait défaut, la traversée peut s’allonger de plusieurs semaines… Nous nous préparons psychologiquement à une traversée de soixante jours et avitaillons riz, pâtes et légumes secs pour trois mois. Les fruits et légumes frais, trouvés au Mercado de abastos y legumbres de Panama City sont superbes ! Nous embarquons aussi cinq jerricans de vingt litres de gazole pour accroître notre autonomie en cas de besoin.
Deux grandes options se présentent pour parcourir les 4000 milles qui nous séparent des Marquises : par le Sud, pour franchir le Pot-au-noir avant les Galápagos ; par le nord, en remontant le long des côtes du Costa-Rica pour passer l’Equateur beaucoup plus à l’ouest. Le vent n’est pas le seul paramètre, il y a aussi les courants : le courant froid de Humboldt qui remonte des côtes sud-américaines pour bifurquer vers l’ouest au niveau des Galápagos, les grands courants de la zone équatoriale, d’ouest en est, donc défavorables à notre progression, enfin des courants d’est en ouest, de part et d’autre de la zone équatoriale. Mais leur positionnement n’est pas stable et dépend de l’intensité du phénomène El Niño… Deux considérations nous font choisir la route du Sud : un vent soutenu de Nord-Est qui va nous pousser très au-delà du golfe de Panama, et la sécurité que représente une escale possible aux Galápagos. Au nord, il y a bien Clipperton, mais cet atoll inhabité est inabordable…
Le 23 avril nous larguons les amarres, non sans nous être débarrassés d’un passager clandestin : une énorme cucaracha (blatte) qui aurait pu pondre une nombreuse descendance dans nos réserves !
Trois jours après le départ, nous comprenons pourquoi le Pot-au-noir est ainsi nommé : des nuages chargés nous recouvrent, il fait nuit en plein jour, un déluge rince le pont, mais c’est l’occasion joyeuse d’une douche plus généreuse que les deux litres que nous nous octroyons chacun habituellement en traversée.
Et le vent tombe. 21 heures de moteur avant de retrouver un souffle d’air. J’ai une pensée pour Alain Gerbault, Jacques-Yves Le Toumelin et d’autres, qui sont passés à cet endroit, sans moteur, il y a quelques décennies. Le Toumelin, qui a quand même mis 23 jours pour atteindre les Galápagos, raconte l’aventure du Suzuki, trois mâts parti de Rouen en 1923, et qui resta paralysé pendant trois mois, la coque percée de toutes parts par des tarets (mollusques bivalves capables de percer le bois), jusqu’à être remorqué par un navire américain jusqu’à Punta Arenas ; fin du voyage.
Un fou à bec bleu et pattes rouges nous accompagne pendant plusieurs jours, posé sur le balcon avant. Il part pêcher en fin de nuit, et revient en début d’après midi. Nous sommes bien sur la route des Galápagos !
Passage de l’Equateur au méridien 88°W. Nous voici dans l’hémisphère Sud. L’étoile polaire disparaîtra peu à peu de l’horizon, et désormais la Croix du Sud, bien campée sur bâbord, accompagnera de son dessin familier notre progression vers l’Ouest.
San Cristobal est en vue. Nous aurons rejoint les Galápagos en 7 jours. Nous ne nous y arrêterons pas : l’escale est excessivement taxée et les visites strictement encadrées, avec recours obligatoire aux prestataires locaux qui en profitent abusivement. Notre fou nous quitte pour rejoindre son nid sur la Roca Pateadora, impressionnante cathédrale de basalte. Nous profitons d’être à l’abri du vent et des vagues pour réparer une fuite du réservoir d’eau douce. L’autonomie, c’est aussi avoir la collection de colles adaptées à toutes sortes de matériaux en milieu salin. Là, il faut fixer du polypropylène, nous avons la bonne colle, ça va tenir…
Les reliefs d’Isabella et de Santa-Maria s’estompent dans notre sillage, tandis que s’ouvrent devant nous 3000 milles (5.500 km) à parcourir sans aucune escale possible, ni retour en arrière (nous devrions alors lutter vainement contre le vent et le courant). Sensation unique et vertigineuse. Il n’y a pas d’autre endroit sur la planète où deux terres émergées sont plus éloignées l’une de l’autre. Nous mettons du sud dans notre ouest pour chercher des alizés bien établis, et les trouvons : pendant une semaine, nous parcourrons 165 à 180 milles par jour, ce qui constitue un record pour le bateau. Le courant nous porte…
Le Pacifique ne mérite pas ce qualificatif. Nous nous faisons chahuter par des houles croisées et poursuivre par des déferlantes assez spectaculaires. Rien à voir avec les quarantièmes rugissants et les cinquantièmes hurlants des hautes latitudes, mais impressionnant quand même… Et personne à l’horizon ou presque : pendant deux jours nous naviguons de conserve, même cap et même vitesse, avec un voilier australien que nous retrouverons aux escales suivantes. Quelques jours après, nous dépassons un catamaran français. C’est tout.
Parfois des dauphins nous accompagnent. À deux reprises, ils ont un comportement particulier, petits cris et acrobaties, pour attirer notre attention. Peu de temps après, nous essuyons des grains forts. Aucun doute, ils nous prévenaient ! Depuis, nous écoutons toujours les dauphins…
Lecture. Dans « La parole de la forêt initiale » Tobie Nathan [2] écrit : « Quel est le fou, dis-le moi, qui pourrait penser que lorsqu’on quitte sa maison, lorsqu’on s’enfonce dans la brousse à la recherche des choses de la nuit, quel est le fou qui pourrait penser que l’on cherche autre chose que soi-même ?» Frappante et profonde résonance avec ce que nous vivons au milieu de cette immensité…
On prête à Aristote d’avoir classé les hommes en trois catégories : les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Oui, j’ai la sensation, après tous ces jours intranquilles loin de tout, d’avoir quitté le monde des vivants et d’avancer dans un inconnu qui n’est au fond pas si loin de celui des morts. Un entre-deux étrange…
Au vingtième jour les réserves de frais s’épuisent. Il ne reste que quelques oignons et citrons. De quoi accommoder quand même le thon de près de 15 kg que nous remontons à grand peine quatre jours avant d’arriver. Thon cru, steak de thon, rillettes de thon, ragoût de thon au lait de coco… bref, thon à tous les repas pour agrémenter cette fin de traversée un peu monotone dans un vent faiblissant. Dans “La lenteur“, Kundera se demande : “Où sont les flâneurs des temps modernes ?” Eh bien, rare privilège, là, c’est nous !
Terre ! Hiva Hoa apparaît dans une brume épaisse. Nous aurons mis 28 jours pour rallier les Marquises depuis Panama, plus vite que ce que nous imaginions, et finalement avec seulement une quarantaine d’heures de moteur. Généreuses Marquises ! Une végétation luxuriante, des fruits et légumes à profusion, des pamplemousses énormes. Et surtout un accueil si chaleureux ! Je comprends ceux qui ont choisi d’y mourir. « Je pars pour être tranquille, pour être débarrassé de l’influence de la civilisation. Je ne veux faire que de l’art simple ; pour cela j’ai besoin de me retremper dans la nature simple ». On dit que Gauguin, qui a laissé un souvenir mitigé de sa fin aux Marquises, avait été un peu déçu, mais ses démons le dévoraient. 115 ans après, les Marquises, parcourues par de gros 4×4 transportant le coprah, sont encore moins à l’état de nature. Mais il en reste quelque chose d’émouvant. Brel y cherchait la même chose. Dans les dernières années de sa vie, il s’était mis au service des Marquisiens. Son petit avion est soigneusement conservé dans un hangar près de la plage, et sa tombe est régulièrement visitée.
Certaines escales sont magiques : Anaho bay, sur l’île de Nuku Hiva, n’est accessible à terre que par un sentier praticable à pied ou dos de mulet. Une modeste pension/restaurant, quelques pêcheurs, un ancien publicitaire français qui vit dans une petite case et se déplace à cheval : 15 habitants que le monde civilisé n’atteint pas. Les raies mantas sont chez elles et personne ne les dérange. Lors de notre dernière escale, après un mois de visite de l’archipel, nous déjeunons chez les habitants d’une petite vallée encaissée, qui nous régalent de poissons crus au lait de coco, et remplissent notre besace de pamplemousses et citrons cueillis ensemble dans leur jardin.
Direction Fakarava, un des principaux atolls des Tuamotu. Six jours de traversée sans difficulté, mais nous prenons la cape (on stoppe le bateau en mettant le foc à contre) avant l’arrivée pour attendre la marée montante : même si le marnage est faible (50 cm), l’écoulement par la passe relativement étroite de l’énorme quantité d’eau emmagasinée dans l’atoll à marée haute génère un fort courant sortant que notre bateau ne pourrait remonter, avec le risque supplémentaire d’être porté sur les récifs. Ça passe ! Il reste à mouiller l’ancre, ce qui, dans les atolls, est un exercice toujours délicat du fait des nombreuses patates de corail dans lesquelles la chaîne se coince quand le vent tourne. Cela nous arrivera plus d’une fois… Les conseils de Bernard Moitessier nous seront précieux.
Exceptés la noix de coco et ses produits dérivés, les atolls ne produisent rien. Leur approvisionnement dépend du petit cargo qui passe ici tous les mercredis pour garnir les magasins. Il faut être là au bon moment car les produits frais s’arrachent dans la journée. Quel contraste avec les Marquises ! Une séquence de Mara’amu, vent de sud tempétueux, nous bloquera dans un mouillage protégé du sud de l’atoll pendant une quinzaine de jours. À terre, il n’y a qu’un petit restaurant, mais dans l’anse plus de quarante voiliers sont venus se réfugier pour laisser passer le mauvais temps. Un voilier tente d’entrer par la passe Sud, et prend son hélice dans une bouée mal placée d’un club de plongée. Privé de propulsion, il est drossé par les vagues sur les récifs coralliens. Coulé. Heureusement tous les passagers s’en sortent.
Nous profitons d’une accalmie pour quitter Fakarava en direction de Tahiti, où nous arrivons moins de deux jours plus tard, juste à temps pour assister aux fêtes du Heiva début juillet. Papeete sera notre point de départ pour visiter les Îles Sous le Vent, Huahiné, Raiatea, Tahaa… Et Bora Bora et ses somptueuses couleurs. Le bleu du lagon est si intense que les sternes blanches qui le survolent en sont colorées. Mais les « resorts » et leurs paillotes sur pilotis ont envahi les rivages. Nous sommes dans le terrain de jeu des grands yachts et grands voiliers de 30, 40, 50 mètres. Concentration des écarts de richesse. Ces navires se louent 250.000 dollars la semaine. Quatre fois la valeur de notre bateau. Mille fois ce que gagne en un mois le pêcheur qui passe à proximité sur sa barcasse…
La navigation vers l’Ouest sera désormais plus inconfortable car nous devrons traverser la ZCPS, Zone de Convergence du Pacifique Sud, avec ses vents irréguliers en force et en direction. De fait, nous devrons renoncer à faire escale aux Îles Cook, le temps agité rendant le mouillage trop hasardeux. Nous poursuivons donc notre route vers Niue, île de corail surélevée formant une galette d’une trentaine de mètres de hauteur et d’une vingtaine de kilomètres de longueur, ce qui fait d’elle la plus grande île exclusivement corallienne du monde. Avec ses deux mille habitants, c’est une monarchie constitutionnelle autonome, liée par un accord de libre association avec la Nouvelle Zélande. Le débarquement avec notre canoë gonflable est sportif, aucun accès n’étant protégé du ressac, mais la visite en vaut la peine : la côte est truffée de grottes, et la barrière de corail qui la borde ménage des « pools » aux eaux vertes et limpides.
Prochaine étape : les Tonga avec ses 170 îles, la plupart inhabitées. Nous atterrissons au petit matin dans l’archipel du Nord, nommé Vava’u group, constitué là aussi d’îles coralliennes surélevées. La baie de Neiafu, bien protégée, est un abri très fréquenté par les navigateurs, et obtenir une bouée dépend de l’humeur et de la bonne volonté du chef du port… C’est là qu’en compagnie de plusieurs bateaux croisés lors de nos étapes précédentes, nous attendrons la période favorable pour nous élancer vers la Nouvelle Zélande. C’est encore la fin de l’hiver austral et les dépressions qui balaient la Nouvelle Zélande peuvent s’accompagner de vents de plus de 100 km/h. Nous avons donc le temps de nous couler dans la vie locale de Neiafu et de faire quelques incursions dans les îlots de l’archipel aux fonds sous-marins riches d’une extraordinaire diversité de coraux de toutes les couleurs.
16 octobre. La météo offre une fenêtre favorable. Nous larguons les amarres. La traversée doit se faire en une dizaine de jours. Si le temps se gâte, nous pourrons faire une halte au tiers de la route, dans le minuscule atoll de Minerva qui émerge tout juste à marée basse et est totalement recouvert à marée haute. On n’y est pas à l’abri du vent, mais au moins les vagues sont brisées et il est possible d’y rester quelques jours si nécessaire. Au large des Tonga, nous traversons une zone réputée pour sa forte activité sismique sous-marine. Il y a quatre ans, une grosse éruption a fabriqué une nouvelle île. Trois mois avant notre passage, une autre de moindre ampleur a projeté à la surface de la mer une nappe de scories flottantes d’une surface équivalente à deux fois Manhattan. Nous franchissons cette zone avec une légère appréhension et atteignons Minerva de nuit, sous une pluie battante. Plusieurs bateaux sont là, en attente, mais l’entrée dans la passe serait trop dangereuse dans ces conditions et nous poursuivons notre route vers le Sud-Ouest. Aux deux tiers de la route, le prévisionniste météo néo-zélandais nous annonce par téléphone satellite que la dépression arrive plus vite et plus au nord que prévu. Il nous conseille de patienter. Trois jours à faire des ronds dans l’eau, chahutés par les vagues, en attendant que ça passe… La dernière partie du parcours, contre le vent et les vagues qui malmènent rudement le gréement, nous amène dans l’étroit chenal d’Opua au milieu d’une nuit sans lune. Vive le GPS et les lampes-torches.
Il aura fallu quinze jours, presque autant que pour traverser l’Atlantique, pour franchir ces 1200 milles nautiques, en une navigation éprouvante pour le bateau et pour l’équipage. Mais nous sommes arrivés !
Un demi tour du monde, 17.000 milles parcourus à 10 km/h, dont plus de 95% à la voile, sans incident majeur. Et nous aurons franchi quatre lignes invisibles : le tropique du Cancer, l’Equateur, le tropique du Capricorne, la ligne de changement de date.
Un exploit ? Non. Mais certainement une aventure dont on ressort très différent.
Le récit complet illustré de ce voyage est consultable sur le site echobravo.blog
[2] Spécialiste français de l’ethnopsychiatrie, né au Caire en 1948.